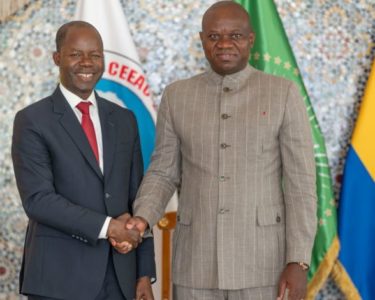Les journalistes représentent une gageure lors de la conquête des suffrages, accusés par endroits de manipulation ou d’endoctrinement au détriment de leur intégrité physique à leur corps défendant.
Par Patrick Bibang, Journaliste
Il est bien connu que la presse n’a de cesse de retenir l’attention au cours d’une élection présidentielle. Les témoignages l’attestent rien qu’en évoquant les péripéties ayant précédé le coup de libération de 2023. L’atmosphère était si pesante que plusieurs journalistes et techniciens s’en émeuvent encore aujourd’hui. Qu’en dirions-nous, au tout début des années 90 des confrères de TV+, radio Soleil, des journaux tels que la Clé, Missamu, la Griffe, le Progressiste et consort ? Les faits étaient globalement révélateurs du contexte de l’époque puisqu’un confrère ne trouvera pas mieux à l’antenne, que de citer une dépêche de l’AFP non loin du lieu du sinistre. Plus près de nous, qu’est-il advenu des communicateurs et communicatrices de l’Union et ceux non moins glorieux de RTN ? Prosaïquement dans l’impuissance la plus absolue, ces derniers ont vu une partie des locaux partir en fumée. C’est pour ainsi rappeller que pour son équipe de la matinale, un autre média fera lui le choix d’un hôtel. Bon nombre de communicateurs sont en effet trop souvent injustement pris à partie. Quelques télévisions privées auront quant-à-elles fait l’amer constat de l’interruption du signal, à défaut pour la radio Nostalgie de suspendre ses programmes par crainte de représailles.
Si bien que quelques années plus tôt, deux professionnels rompus avaient été épargnés au PK 6 grâce à une réplique verbale en langue vernaculaire. D’autres scènes se passeront de tout commentaire. C’est ici l’occasion d’interpeller les acteurs politiques de tous bords, à côté de la désapprobation des autorités en place. Il nous revient d’ailleurs que la ministre de la communication Laure Olga Gondjout avait joint le journaliste lynché à l’échangeur de la Démocratie avant de faire une communication à ce sujet au conseil des ministres, sitôt informée pendant la Grande nuit électoral en 2009. Une sensibilisation pourrait précéder les moments aussi sensibles que représentent des joutes électorales. C’est déjà un acquis que les candidats se soumettent à un code de bonne conduite. L’avenir de notre démocratie en dépend également, sans commune mesure. Le dialogue national inclusif a tôt fait d’apeller à l’adoption d’une loi relative à l’accès à l’information d’intérêt public ainsi qu’à une modification de la loi organique 14/91 portant création, attributions et organisation de l’autorité de régulation de la communication aux fins d’une réelle autonomie. Le programme des Nations-Unies pour le développement mais également l’organisation internationale de la Francophonie, l’Union Européenne et l’UNOCA jouent dans cette optique un rôle crucial à-côté de celui du Sénégal, du Cameroun ainsi que la Côte d’Ivoire, le Maroc, la France, les États-Unis, la Chine et l’Egypte dans le cadre de la formation et le renforcement des capacités des journalistes.
La controverse n’a pas lieu d’être, surtout que l’opportunité de bâtir un nouvel ordre socio-économique est patent dans notre pays. Une victoire à défaut, une défaite à une élection présidentielle ne dépend pas littéralement du temps accordé sur les antennes d’une télévision ou d’une radio. Il en est de même avec les contenus des journaux conventionnels ou en ligne. L’universalité et l’intengibilité de l’éthique informationnelle recommande d’avantage de professionnalisme à l’heure de la bipolarité des technologies de l’information. L’usage exagéré d’hyperbole ajouté à un désir d’accrocher l’audimat, peut par moments rivaliser avec l’objectivité. Le Gabon occupe le 56e rang sur 180 nations selon le dernier rapport de Reporter sans frontières sur les libertés de la presse dans le monde. Le pays sera en septembre prochain l’hôte de 200 journalistes de 50 pays, dans le cadre des assises internationales de l’union de la presse francophone pour la 51e fois de leur histoire.